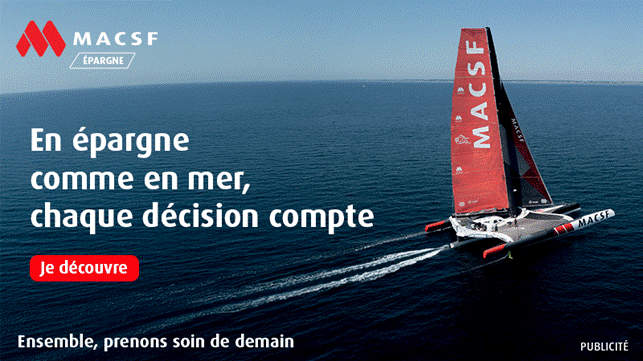Édito

En 1996, les ordonnances Juppé mettaient fin au paritarisme dans la gestion de l’Assurance Maladie.
Avec le PLFSS 2026, c’est désormais le dialogue conventionnel qui risque d’être remis en cause.
Depuis des décennies, les syndicats médicaux ont construit, en partenariat d’abord avec les représentants des cotisants, puis avec ceux de l’État au sein de la CNAM, un fonctionnement conventionnel qui a permis à notre système de soins d’être longtemps cité en exemple.
Mais les politiques publiques irresponsables de ces dernières années ont provoqué une crise démographique médicale sans précédent, entraînant une dégradation inacceptable de l’accès aux soins.
La convention médicale, signée en juin 2024, avait pour objectif de répondre à cette problématique, en conciliant amélioration de l’accès aux soins et soutenabilité financière du système de santé.
Le dialogue conventionnel reste le seul moyen d’assurer un équilibre entre les droits et les devoirs des médecins, en particulier des médecins libéraux, acteurs essentiels du premier recours qui assurent 80 % des consultations et 75 % des actes techniques.
Or, le PLFSS 2026 vient fragiliser cette dynamique :
– Un ONDAM de ville à 0,9 %, inférieur à l’inflation, contre 2,4 % pour l’hôpital, constitue une véritable pénalisation de la médecine libérale, pourtant pilier du premier recours.
– L’article 24 stigmatise à nouveau certaines spécialités, cette fois les radiothérapeutes et les néphrologues, après les biologistes et les radiologues l’an dernier. Il permet surtout au Directeur général de la CNAM de réviser unilatéralement la valeur des actes, rompant ainsi le dialogue et la confiance.
Les textes législatifs doivent fixer un cadre général, non se substituer à la négociation conventionnelle. L’article 24 doit donc être supprimé, faute de quoi nous entrerions dans une médecine administrée, étatisée, aggravant encore les difficultés d’accès aux soins.
Comment dénoncer, dans le même temps, le manque de rentabilité des centres de santé et fragiliser la médecine libérale, pourtant plus efficiente, par une insécurité grandissante de son exercice ?
C’est la convention médicale qui doit permettre les ajustements nécessaires, notamment dans la révision de la CCAM technique actuellement en cours.
De même, l’article 26, qui stigmatise le secteur 2, doit être supprimé.
Il faut au contraire construire, dans le cadre conventionnel, un espace de liberté tarifaire solvabilisé.
Les dépassements abusifs doivent être sanctionnés, mais lorsque les finances publiques ne permettent plus de valoriser les actes médicaux à leur juste niveau – comme le rappelait Raymond Barre en 1980 lors de la création du secteur 2 -, cet espace de liberté est indispensable.
La grave crise politique que traverse notre pays ne doit pas conduire, par des mesures précipitées ou idéologiques, à mettre en péril la médecine libérale.
C’est au contraire en faisant vivre la convention médicale, signée par des syndicats libéraux et responsables – au premier rang desquels la CSMF – que nous pourrons garantir l’accès aux soins et relever les défis actuels.
Dr Bruno PERROUTY,
Président Les Spécialistes CSMF
Dossier OPTAM
Sauvons le soldat OPTAM !
Argumentaire pour une révision équitable du dispositif
L’OPTAM (Option pratique tarifaire maîtrisée) est un dispositif conventionnel qui permet aux médecins exerçant en secteur 2 et certains médecins de secteur 1 de pratiquer des honoraires libres, tout en s’engageant à maintenir une proportion définie d’actes à tarifs opposables et à respecter un taux moyen de dépassement, fixés par l’Assurance Maladie. En contrepartie de cet engagement à modérer leurs tarifs, les praticiens bénéficient des revalorisations conventionnelles applicables au secteur 1, peuvent coter les consultations complexes et très complexes, et perçoivent une prime annuelle correspondant à une remise de charges sociales.
L’OPTAM avait pour ambition de favoriser l’accès aux soins en limitant le reste à charge des patients, tout en maintenant une certaine souplesse d’exercice pour les praticiens libéraux en secteur 2. Il concerne également des médecins de secteur 1 qui ont pu adhérer à l’option avant 2016 sous certaines conditions. En théorie, il permettait un compromis vertueux entre accessibilité des soins et attractivité de l’exercice libéral. Dans la pratique, il est aujourd’hui largement remis en question par les professionnels de terrain en raison des révisions d’objectifs consécutifs à la dernière convention médicale. Les points de blocage sont multiples :
Inéquités territoriales :
Le premier problème soulevé par les praticiens concerne l’inéquité manifeste entre départements. Les taux fixés (taux moyen de dépassement et pourcentage de patients à tarif opposable) varient de manière importante, sans justification.
Des professionnels exerçant dans des zones fortement sous-dotées comme le Loir-et-Cher peuvent se voir imposer des objectifs plus contraignants que leurs confrères d’Indre-et-Loire, un département pourtant mieux pourvu en spécialistes. Cette logique introduit une forme de mise en concurrence territoriale totalement contre-productive et injuste.
Mécanisme punitif contre-productif
Le fonctionnement actuel de l’OPTAM est fondé sur une logique dégressive : plus un praticien respecte les objectifs (en limitant ses dépassements ou en acceptant davantage de patients au tarif opposable), plus les objectifs se durcissent à l’avenant suivant. Cela revient à dire que plus un praticien est vertueux, plus il est sanctionné.
Cela décourage fortement les praticiens les plus engagés, qui avaient initialement fait le choix d’un exercice accessible.
Opacité du dispositif et imprévisibilité économique
Le calcul des taux fixés par la CNAM reste opaque pour les praticiens. Il n’est pas possible d’anticiper leur évolution d’un avenant à l’autre ni de calculer le tarif de consultation permettant de respecter les objectifs.
Bien que le calcul théorique soit explicité dans la convention et dans le contrat, il n’existe aucun outil opérationnel permettant de calculer les montants de consultation permettant le respect des objectifs ou d’anticiper l’évolution des taux et donc de planifier l’évolution des recettes du médecin. Cela empêche d’établir un chiffre d’affaires prévisionnel, de planifier des investissements ou un recrutement.
Cela entre en contradiction avec la responsabilité entrepreneuriale qui est pourtant attendue du médecin libéral.
Objectifs démesurés en tarif opposable : un effet pervers majeur
L’exigence de taux très élevés de consultations à tarif opposable est économiquement incohérente. Cela oblige les praticiens à faire reposer l’équilibre économique de leur activité sur un nombre de consultations en secteur 2 de plus en plus restreint, et donc à appliquer des dépassements plus élevés pour compenser. Le système produit ainsi l’effet inverse de ce qu’il prétend encourager.
Incohérences entre praticiens de même spécialité
Le calcul basé sur le « réel observé » sur la période de référence peut conduire à des taux différents entre praticiens exerçant pourtant dans des conditions identiques.
Exemple : deux spécialistes exerçant dans le même cabinet se voient fixer des objectifs sensiblement différents, pour des activités cliniques similaires. Cela génère un sentiment d’arbitraire et d’incompréhension.
Les praticiens qui adhèrent à l’OPTAM font déjà un choix responsable et éthique. Ils acceptent de limiter leurs dépassements, d’assurer une proportion de leur activité à tarif opposable, et de garantir à leurs patients un meilleur remboursement. Ce choix n’est ni contraint, ni opportuniste : il repose sur des convictions professionnelles et sur une volonté de participer à un accès plus équitable aux soins.
CONTEXTE ACTUEL
Face à l’accumulation d’incohérences, à l’imprévisibilité, de nombreux praticiens expriment une défiance croissante. Cette défiance est accentuée par les récentes actualités avec le report des revalorisations prévues en juillet 2025, obligeant à la révision des taux, avec le renvoi de nouveaux avenants. La multiplication des sollicitations par la caisse, avec des objectifs divergents, accentue la sensation d’opacité du dispositif. Certains médecins envisagent de sortir de l’OPTAM, non par opportunisme, mais parce qu’ils n’y trouvent plus de sens ni de stabilité. Si cette dynamique s’engage, elle se traduira inévitablement par une augmentation du reste à charge et par un recul de l’accès aux soins.
En pratique :
La date limite de signature des nouveaux contrats OPTAM est fixée au 3 novembre 2025, pour une entrée en application au 1er janvier 2026. Aucun indu ne sera appliqué sur l’année 2025.
Pour les secteurs 1, la signature de l’OPTAM reste intéressante pour continuer à bénéficier du dispositif. Pour les secteurs 2, la signature peut être intéressante si les taux proposés paraissent adaptés à votre pratique et à votre patientèle.
Selon la CNAM, les nouveaux taux OPTAM intègrent le partage des gains selon le respect des taux antérieurs. Il ne peut donc pas y avoir de perte de chiffre d’affaires pour les praticiens déjà signataires. Toutefois, vous ne pourrez répercuter sur vos tarifs habituels les revalorisations de la nouvelle convention qu’à 60% au maximum, à condition d’avoir respecté vos objectifs (avec par conséquent une diminution de la valeur numéraire de votre dépassement habituel sur les actes revalorisés).
Ainsi, pour l’APC passant de 56,50 € à 60 €, un praticien qui facturait 80 € auparavant pourra augmenter son tarif de 2,10 € (60% de la revalorisation de l’acte), soit 82,10 €. La hausse du tarif opposable réduit donc mécaniquement son dépassement de 1,40 €.
CONCLUSION :
L’OPTAM peut rester un levier utile pour améliorer l’accès aux soins tout en respectant l’exercice libéral. Mais pour être durable et juste, le dispositif doit être réformé en assurant une véritable équité entre professionnels, en offrant une lisibilité totale aux praticiens, et en proposant une évolution juste et raisonnée des objectifs.
Sans cela, l’OPTAM risque de se vider de son sens, et de ses signataires, au détriment de l’accès aux soins pour les patients.
La CNAM a annoncé que le dispositif OPTAM tel que nous le connaissons devra évoluer à l’issue de la refonte de la CCAM. C’est l’occasion pour nous de faire valoir les évolutions qui nous semblent nécessaires pour que ce dispositif reste un outil pertinent pour l’accès aux soins et la préservation d’un espace de liberté tarifaire.
Propositions :
- Harmonisation des taux par spécialité à l’échelle nationale, sauf exceptions justifiées.
- Etablissement d’un plancher pour le taux de dépassement moyen et d’un plafond pour le pourcentage d’acte au tarif opposable. En tenant compte de la prime OPTAM versée en totalité, un dépassement moyen d’environ 15 à 20 % suffit généralement à rendre le secteur 2 OPTAM plus avantageux que le secteur 1. Une proportion modérée d’acte au tarif opposable permet de répartir plus équitablement les dépassements d’honoraires au sein de la patientèle.
- Révision des objectifs sur la base des taux-cibles précédents, et non du taux réel atteint sur la période de référence.
- Transparence totale des méthodes de calcul et construction d’un simulateur, permettant de construire une projection réaliste dès l’installation : tarif de consultation ajusté selon les taux cibles, budget prévisionnel cohérent, respect des objectifs.
- Solvabilisation des dépassements d’honoraires par la complémentaire santé pour les praticiens signataires de l’OPTAM.
- Ouverture du dispositif : L’OPTAM, aujourd’hui réservé aux médecins titrés éligibles au secteur 2, pourrait évoluer vers un dispositif de liberté tarifaire solvabilisée également accessible aux praticiens engagés sur leur territoire pour faciliter l’accès aux soins. Cette ouverture permettrait de reconnaître l’investissement territorial des médecins.
Les Spécialistes CSMF rappellent que la clé de la réussite réside dans la création d’un véritable espace de liberté tarifaire solvabilisé, respectueux du travail des praticiens et au service des patients.
Double facturation à l’hôpital : stop ou encore ?
Double facturation : quand la CNAM ferme les yeux.
Il n’est pas une journée sans que l’on évoque le déficit croissant de l’assurance-maladie et la nécessité de mesures visant à réaliser des économies substantielles. Bien souvent la médecine libérale est seule mise à contribution, comme le montre le protocole d’imagerie dans la LFSS de 2025 avec les 300M€ d’économies et maintenant l’article 24 du PLFSS 2026.
Paradoxalement, et depuis de nombreuses années, sans que cela n’émeuve grand monde, un système de double facturation se pérennise, conduisant la CNAM à payer deux fois pour une même prestation.
Pour mémoire, dans le cadre d’une hospitalisation en établissement privé, les praticiens libéraux sont rémunérés à l’acte, l’établissement percevant un financement par le biais de la tarification du GHS qui en l’espèce n’inclut pas les honoraires.
Dans le cadre d’une hospitalisation en établissement public, l’établissement perçoit un GHS dont la tarification inclut la rémunération de l’acte, et ce dans la mesure où les praticiens sont salariés. Dans le cadre particulier de l’activité libérale statutaire des praticiens hospitaliers, ces derniers facturent et perçoivent des honoraires directement, mais pour autant l’établissement perçoit un GHS basé sur la tarification de l’hospitalisation publique, incluant également la rémunération de l’acte qui est donc réglé deux fois par la CPAM.
La Cour des Comptes dans son rapport d’octobre 2023 en fait état et sa première recommandation propose : « réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de manière à éviter que l’assurance-maladie paye 2 fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une seconde fois au titre des honoraires des praticiens ».
Force est de constater qu’à ce jour aucune mesure particulière n’a été prise pour évaluer l’impact financier de ce dispositif inéquitable, a fortiori pour le modifier. Dans le contexte économique contraint actuel, et sans remettre en cause le principe de l’activité libérale statutaire des praticiens hospitaliers, ne serait-il pas pertinent de se reconsidérer enfin ces modalités de double facturation ce qui pourrait conduire a de potentielles économies.
Il suffirait de reprendre un amendement présenté en 2015 par Messieurs les députés Tian et Abou et appliquer le GHS privé au lieu du GHS public pour l’activité privée des praticiens hospitaliers.
PLFSS 2026 : les amendements proposés par la CSMF
Amendement n°1 : rétablissement de l’obligation vaccinale contre la grippe pour les professionnels de santé
Article additionnel après l’article 20
I. – L’obligation de vaccination contre la grippe prévue à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique est rendue applicable à l’ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4311-1 du même code exerçant dans les établissements de santé publics et privés.
II. – Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires, et notamment celles suspendant l’application de cette obligation.
Exposé des motifs
L’article 20 du PLFSS 2026 introduit une obligation de vaccination antigrippale pour les professionnels de santé libéraux.
Dans un souci de cohérence et d’équité de traitement entre les différentes catégories de soignants, il est impératif que les personnels hospitaliers soient également soumis à cette obligation.
En effet, les établissements publics de santé accueillent des patients particulièrement vulnérables, et les professionnels y exerçant sont exposés à un risque accru de transmission nosocomiale du virus de la grippe.
Cet amendement vise donc à rétablir la pleine effectivité de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, en supprimant la suspension réglementaire actuellement en vigueur.
Amendement 2 : Suppression de la possibilité de collecte des franchises par les médecins
Article 18
Supprimer les alinéas 4, 5, 12 et 13.
Exposés des motifs
L’une des mesures proposées par l’article 18 consiste à permettre le paiement des participations forfaitaires et franchises directement auprès de certains professionnels de santé, en particulier des médecins, pour les actes et consultations.
Si les médecins doivent à l’avenir percevoir ces franchises avant de les reverser à l’assurance maladie, lorsqu’ils pratiquent le tiers payant intégral pour les patients en ALD, c’est la fin de ce tiers payant.
Cette modalité créerait, de fait, une rupture du tiers payant intégral. En effet, elle reviendrait à obliger le patient à effectuer un paiement au moment de la consultation, alors même que le principe du tiers payant vise à lui éviter toute avance de frais. Elle introduirait en outre une complexité administrative supplémentaire pour les praticiens, qui deviendraient collecteurs de la franchise pour le compte de la Caisse, sans garantie d’efficacité ni de simplification réelle
Elle risquerait également de décourager les médecins de proposer le tiers payant, alors même que celui-ci constitue un levier essentiel d’accès aux soins et de modernisation du parcours patient.
Pour ces raisons, il est donc demandé la suppression de la disposition imposant aux médecins la collecte des franchises médicales avant leur reversement à l’assurance maladie. Le recouvrement de ces franchises doit rester de la responsabilité exclusive des caisses d’assurance maladie, via les mécanismes automatisés actuels, sans intervention directe du professionnel de santé.
Amendement n°3 : Autoriser les médecins généralistes à stocker des vaccins contre la grippe et le covid
Article additionnelle après l’article 20
Il est ajouté un alinéa à l’article L3111-1 du code de la santé publique ainsi rédigé :
« Les médecins généralistes peuvent détenir, en vue de son administration, le vaccin contre la grippe saisonnière pour les personnes ciblées par les recommandations identifiées dans le calendrier vaccinal mentionné à l’alinéa 1.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités applicables à la détention du vaccin et à la traçabilité. »
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à autoriser la détention par le médecin généraliste, en vue de l’administration du vaccin contre la grippe saisonnière et le COVID pour les personnes visées dans les recommandations du calendrier vaccinal.
En effet, les chiffres des précédentes campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et le COVID montrent que la couverture vaccinale diminue tous les ans et est toujours très insuffisante.
Plusieurs freins sont identifiables pour expliquer la faiblesse de cette couverture vaccinale, au premier rang desquels le parcours de soins du patient. Actuellement, après avoir reçu le bon de vaccination antigrippale, le patient concerné doit encore se rendre chez son pharmacien pour la délivrance du vaccin puis doit recevoir l’injection par le pharmacien ou un autre professionnel. L’objectif de cette disposition est de permettre d’être vacciné directement par le médecin généraliste lorsque le patient est amené à le consulter. En effet, si le médecin conseille au patient de se vacciner, bon nombre d’entre eux, pourtant pas opposer par principe à ces vaccinations, ne les feront pas par négligence. Là, le patient quitterait vacciné le cabinet de son médecin.
Amendement 4 : Praticien territorial de médecine ambulatoire
Article 21
A l’alinéa 12, supprimer « lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil ».
Exposé des motifs
L’article 21 prévoit que les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil.
Les contraintes sont importantes pour le médecin qui contractualise avec la caisse. La rémunération complémentaire doit donc être continue tant que ce médecin reste installé dans ce territoire et rempli toutes les obligations de son contrat avec l’ARS.
Amendement n°5 : Structures spécialisées de soins non programmés
Article 21
1° A l’alinéa 26, supprimer les mots « à titre principal ».
2° Rédiger ainsi l’alinéa 32 : « III. Les modalités de rémunération des soins non programmés et la mise en œuvre du 10° de l’article L. 162-14-1 dans sa rédaction issue de la présente loi, font l’objet d’une négociation dans le cadre conventionnel mentionné à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »
Exposé des motifs
L’article 21 vise à structurer et financer les soins non programmés en ville afin de mieux articuler la réponse entre la médecine de ville et les établissements de santé.
Le présent amendement poursuit un double objectif :
- D’une part, la suppression des mots « à titre principal » afin de ne pas restreindre ces missions à des structures exclusivement dédiées aux soins non programmés. Les maisons de santé pluridisciplinaires et autres structures de premier recours doivent pouvoir y contribuer sans créer un nouvel échelon isolé du reste de l’offre de soins.
La limitation telle que le prévoit cet article risquerait en sus de créer un nouveau niveau d’organisation redondant, détaché du premier recours, et d’attirer des médecins qui pourraient exercer comme praticiens traitants ou urgentistes. - D’autre part, la réécriture du III vise à préserver la nature strictement conventionnelle de la négociation sur la rémunération des professionnels de santé. Autoriser une modification par arrêté en cas d’échec des discussions reviendrait à vider de sa substance le dialogue conventionnel, qui constitue un pilier de l’organisation du système de santé libéral et du partenariat entre l’État et les représentants des praticiens.
Cet amendement garantit ainsi à la fois la cohérence de l’organisation territoriale des soins et le respect du cadre conventionnel qui fonde les relations entre l’assurance maladie et les professionnels de santé.
Amendement n°6 : Campagne tarifaire
Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :
Article additionnel après l’article L.162-22-3-1 du code de la sécurité sociale :
« À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-3-1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication de ces nouveaux tarifs et dotations.
L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants.
Les établissements et les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus.
Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »
Exposé des motifs
Chaque année, les tarifs applicables aux prestations des établissements de santé privés sont fixés par arrêté ministériel.
Cependant, la publication de cet arrêté intervient régulièrement avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard.
Ce décalage a pour effet de bloquer la facturation des actes, de retarder la rémunération des médecins libéraux exerçant en établissement, et de compliquer les remboursements des patients.
Il entraîne également des tensions de trésorerie pour les établissements de santé.
Afin de garantir la continuité financière et tarifaire du système, le présent amendement prévoit que, tant que le nouvel arrêté tarifaire n’a pas été publié, les tarifs de l’année précédente demeurent provisoirement applicables.
L’assurance maladie procèdera ensuite aux régularisations nécessaires, sans préjudice pour les praticiens ni pour les assurés.
Ce mécanisme, neutre sur le plan budgétaire, vise à éviter qu’un simple retard administratif ne suspende la facturation et la rémunération des soins, tout en assurant la continuité du service rendu aux patients.
Amendement n°7 : Refus des coups de rabots
Article 24
Supprimer
Exposé des motifs
L’article 24 introduit un mécanisme permettant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d’habiliter le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie à procéder à des baisses unilatérales de tarifs dans certains secteurs jugés à « rentabilité manifestement excessive ».
Une telle disposition, en assimilant certaines spécialités à des secteurs de rente, porte atteinte à la confiance entre l’État, l’Assurance maladie et les professionnels de santé. Elle laisse entendre que certaines activités médicales seraient indûment rémunérées, alors que leurs tarifs résultent d’accords conventionnels négociés et encadrés.
La régulation des dépenses de santé ne saurait relever de décisions unilatérales. Elle doit rester fondée sur le dialogue, la négociation et la coresponsabilité dans le cadre conventionnel, garant d’un équilibre entre soutenabilité financière et reconnaissance du travail médical.
Plutôt que des « coups de rabot » administratifs, il serait plus pertinent de développer des mécanismes de régulation concertés, fondés sur la responsabilité territoriale des acteurs de santé et la pertinence des pratiques médicales.
Ces leviers sont plus efficaces et plus respectueux du rôle des médecins dans l’organisation du système de soins.
Il convient donc de supprimer cet article, dont la logique punitive et centralisée est contraire à l’esprit de concertation qui doit prévaloir dans les relations entre l’Assurance maladie et les médecins libéraux.
Amendement n°8 : Dépassements d’honoraires
Article 26
Suppression
Exposé des motifs L’article 26 du PLFSS 2026 vise à renforcer l’incitation au conventionnement des professionnels de santé en soumettant les revenus tirés d’activités non conventionnées à une sur-cotisation dont le taux pourra être fixé par décret.
Or, cette mesure introduit une insécurité économique pour les praticiens et risque d’avoir un effet contre-productif sur l’attractivité de l’exercice libéral. Le dispositif actuel, prévu à l’article L. 646-3 du code de la sécurité sociale, fixe un taux de 3,25 % sur les revenus non conventionnés (dépassements d’honoraires, expertises, actes esthétiques). Donner au pouvoir réglementaire la possibilité de relever ce taux de manière illimitée revient à instaurer une sanction fiscale sans concertation.
Plutôt que de pénaliser indistinctement les dépassements, il convient de cibler les dépassements excessifs et de renforcer les dispositifs incitatifs existants, notamment l’OPTAM, déjà choisi par plus de 56 % des médecins de secteur 2.
La maîtrise des dépassements d’honoraires doit résulter d’une négociation conventionnelle entre la CNAM et les syndicats représentatifs, et non d’une taxation unilatérale.
Amendement 9 : Espace de liberté tarifaire
Article additionnel après l’article 26
A l’article L162-5 du code de la sécurité sociale, ajouter un 28° ainsi rédigé :
« Les conditions de mise en œuvre d’un espace de liberté tarifaire accessible à l’ensemble des médecins libéraux en contrepartie d’engagements permettant d’améliorer l’accès aux soins, permettant la prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire des dépassements d’honoraires.»
Exposé des motifs
Les dépassements d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé ont connu une forte augmentation au cours des dernières années, contribuant à réduire l’accès aux soins pour certains patients. Si la régulation de ces dépassements constitue un objectif légitime, elle ne saurait reposer exclusivement sur des mécanismes de sanction ou de taxation, tels que ceux prévus à l’article 26 du PLFSS 2026.
La maîtrise des tarifs doit s’appuyer sur une approche conventionnelle et équilibrée, conciliant liberté d’exercice, juste rémunération et modération tarifaire. L’expérience du dispositif de l’OPTAM démontre qu’il est possible d’encadrer les honoraires tout en maintenant une attractivité économique pour les praticiens. Toutefois, ce dispositif demeure aujourd’hui limité à une partie seulement des médecins, créant des inégalités et freinant son impact global sur la régulation tarifaire.
Il apparaît donc nécessaire d’ouvrir un espace de liberté tarifaire encadrée à l’ensemble des médecins libéraux, quelle que soit leur spécialité ou leur secteur. Cet espace permettrait aux praticiens de pratiquer des honoraires adaptés à la complexité de leurs actes ou à leur mode d’exercice, dans un cadre négocié avec l’assurance maladie, en contrepartie d’engagements permettant d’améliorer l’accès aux soins. Ainsi seraient valorisés les médecins qui s’engagent à participer à des organisations collectives qui permettent d’améliorer l’accès aux soins : permanence des soins (PDSA), service d’accès aux soins (SAS), maitre de stage, adhésion à une CPTS, à une ESS, …
La solvabilisation de ces dépassements par les organismes d’assurance maladie complémentaire garantirait l’accessibilité financière des soins pour les patients.
En inscrivant dans la loi l’obligation pour la convention médicale de définir les conditions de mise en œuvre de cette liberté tarifaire encadrée, le présent amendement vise à favoriser l’adhésion au conventionnement, améliorer l’accès aux soins, et préserver la soutenabilité économique de l’exercice médical libéral.
Amendement n°10 : Suppression des sanctions en cas de non-respect de l’alimentation et de la consultation du Dossier Médical Partagé
Article 31
Supprimer
Exposé des motifs L’article 31 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 vise à renforcer les obligations d’alimentation et de consultation du dossier médical partagé (DMP), intégré à « Mon espace santé », en prévoyant un régime de sanctions financières à l’encontre des professionnels et établissements de santé ne respectant pas ces obligations.
Si l’objectif de renforcer la coordination des soins et la qualité du suivi médical est pleinement partagé, la méthode proposée apparaît inopérante et injustement pénalisante pour les professionnels de santé, au regard de l’état actuel du système.
En effet, les principaux obstacles à l’alimentation effective du DMP ne relèvent pas des médecins, mais des limitations techniques et structurelles des logiciels métiers utilisés.
Aujourd’hui, les éditeurs de logiciels ne permettent pas l’alimentation automatique et fluide du DMP, en raison d’un manque d’interopérabilité entre les systèmes et de l’absence d’un véritable droit à la portabilité des données médicales.
Il est dès lors illusoire d’imposer aux praticiens une obligation de résultat sur un outil dont ils ne maîtrisent ni les flux techniques ni l’intégration logicielle.
Avant toute contrainte, il convient de garantir la portabilité gratuite et simple des données médicales entre logiciels métiers, et de lever les obstacles persistants à l’interopérabilité entre éditeurs.
À ce jour, la CNAM impose un DMP structuré, ce qui complexifie encore la mise en œuvre technique pour les praticiens déjà équipés de logiciels non compatibles.
Par ailleurs, l’obligation d’alimentation et de consultation du DMP ne saurait peser uniquement sur les médecins libéraux. Les médecins hospitaliers participent eux aussi au parcours de soins et doivent être soumis aux mêmes exigences pour garantir une continuité réelle de l’information médicale. Sans cette symétrie, le dispositif crée un déséquilibre et une perte de chance manifeste pour les patients, dont le DMP resterait partiellement vide.
Enfin, il convient de rappeler la réalité du terrain : de nombreux médecins, notamment parmi les plus âgés ou proches de la retraite, ne disposent pas d’outils informatiques adaptés ou maîtrisés.
Dans ce contexte, assortir ces obligations de sanctions financières apparaît non seulement disproportionné, mais également inapplicable, tant que les infrastructures, les outils logiciels et l’accompagnement technique ne sont pas pleinement opérationnels.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 31, afin de ne pas instaurer un régime de sanction inéquitable et inadapté.
Amendement n°11 : Améliorer la pénétration des biosimilaires et des génériques en ville
Article 33
Après l’alinéa 26 ajouter un alinéa ainsi rédigé :
D – Après le dernier alinéa de l’article L5125-23-2 du code de la santé publique, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Afin de prévenir les effets indésirables liés à la variabilité perçue du traitement et de garantir la confiance thérapeutique du patient, le pharmacien veille, lors du renouvellement d’une prescription, à délivrer le même médicament biologique similaire que celui précédemment dispensé, sauf en cas de justification médicale, d’indisponibilité du produit ou de décision contraire du prescripteur dûment motivée. Toute modification du médicament biologique similaire délivré doit faire l’objet d’une information du patient et d’une mention dans le dossier pharmaceutique. »
Exposé des motifs
La substitution entre médicaments biologiques similaires constitue un levier important pour la soutenabilité du système de santé. Toutefois, les changements répétés de biosimilaires peuvent générer, chez certains patients, des effets nocebo et une baisse de l’observance thérapeutique.
Afin de préserver l’efficacité thérapeutique et l’adhésion au traitement, il est proposé d’inscrire dans la loi le principe selon lequel un patient ayant initié un traitement avec un médicament biologique similaire doit, sauf raison médicale ou indisponibilité, continuer à recevoir le même produit lors des renouvellements.
Cette mesure vise à garantir la continuité du traitement, la stabilité clinique du patient et la sécurité de la substitution, tout en respectant la liberté de prescription et les exigences de traçabilité pharmaceutique.